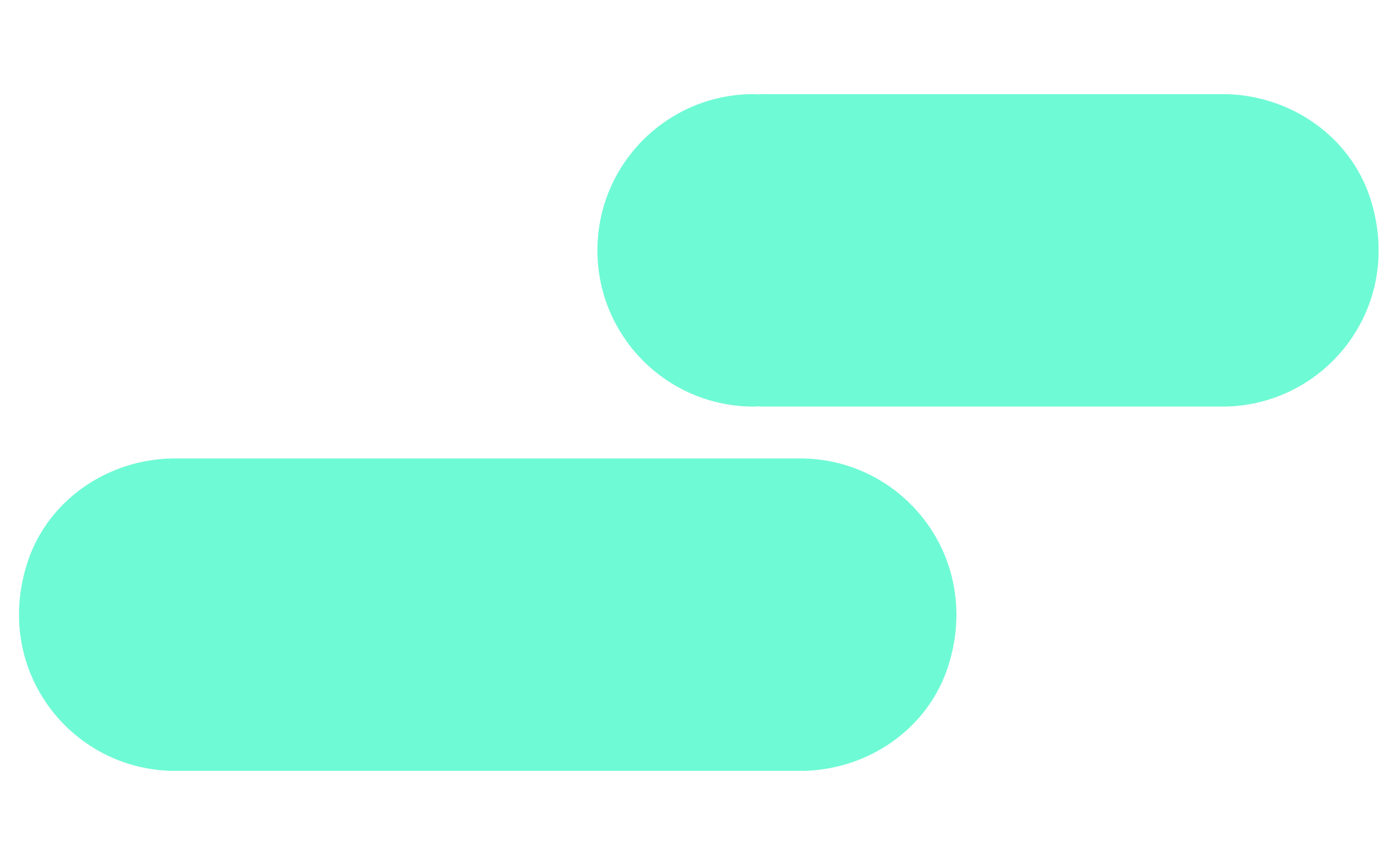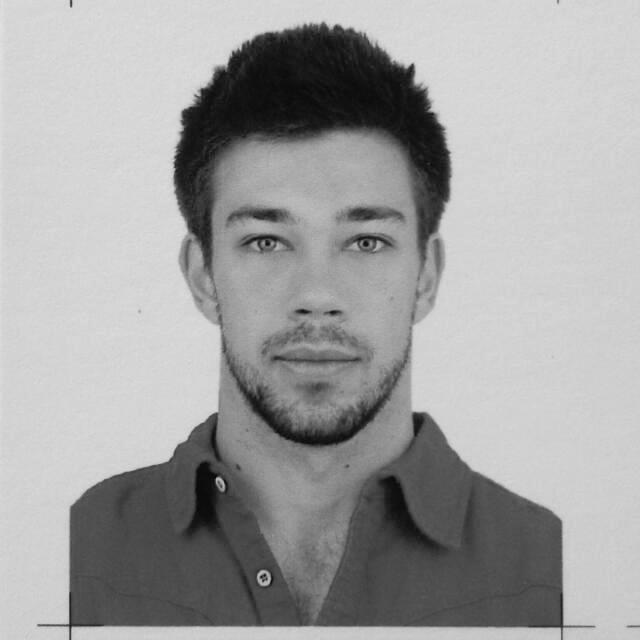Le 2 mai prochain, la Commission juridique du Conseil national devra se prononcer sur le projet législatif consacré à la protection des lanceuses et lanceurs d’alerte. Alors que les premières initiatives parlementaires visant à clarifier le statut des whistleblowers remontent à mai et juin 2003, pourquoi tant de peine à concrétiser en droit suisse un tel outil d’utilité publique, nécessaire dans la lutte contre la corruption ainsi qu’à la découverte d’autres comportements amoraux restant invisibles ?
Depuis les années 1990, différents scandales nationaux et internationaux ont progressivement amené la problématique de la définition des lanceurs d’alerte ainsi que de leur protection au centre du débat public (notamment par foraus); on évoquera les Swiss Leaks, l’affaire Birkenfeld, l’affaire des services sociaux de Zurich ou encore l’affaire Meili, du nom de l’agent ayant dû fuir la Suisse pour les Etats-Unis, qui lui accorderont par la même occasion l’asile politique.
Ce dernier exemple souligne les différences culturelles liées à la perception de ces personnes appartenant à une organisation publique ou privée et qui donnent l’alerte sur des irrégularités constatées au sein de celle-ci. Les USA ont par exemple développé un régime juridique hautement favorable aux whistleblowers (False Claims Act (1863) ; Sarbanes-Oxley Act (2002) et le Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act de 2010) et qui est par ailleurs déjà applicable aux sociétés suisses cotées en bourse aux Etats-Unis. Le 16 avril 2019, c’est le Parlement européen qui a voté à une écrasante majorité une directive facilitant le droit de signalisation et la protection des lanceurs d’alerte.
Qu’en est-il en Suisse ? Si le secteur public fédéral, ainsi que certains cantons, se sont dotés d’un régime juridique cadrant le droit ou l’obligation de leurs fonctionnaires à signaler des irrégularités ainsi que la protection en découlant, c’est à un vide législatif désolant que sont confronté·e·s les employé·e·s du secteur privé. La jurisprudence du Tribunal fédéral et plus récemment celle de la Cour Européenne des Droits de l’Homme ont partiellement comblé ce vide (avec des résultats différents), en développant des critères pour qualifier un signalement justifié. Malgré ceux-ci, les employé·e·s du secteur privé n’ont à ce jour que très peu de chances de pouvoir raisonnablement se déterminer sur leur droit à une protection juridique et sur son étendue avant de communiquer leurs soupçons.
Le projet législatif en cours comporte premièrement certains points réjouissants, notamment en précisant les irrégularités à signaler, en établissant une potentielle protection contre les répercussions pénales ou encore en tolérant d’éventuelles communications anonymes. Cependant d’autres choix opérés semblent, au vu des standards internationaux émergeants (par exemple l’Art. 33 UNCAC et Art. 22 STE 173), plus problématiques dans l’optique d’une protection effective des lanceurs d’alerte.
On peut en effet s’interroger sur le format du système de signalement « en cascade » préconisé, où un whistleblower devrait, somme toute, quasi systématiquement commencer par adresser sa communication à son entreprise. Ce d’autant plus qu’un canal de communication mis en place par son employeur·euse·s forcerait presque invariablement le whistleblower à l’utiliser, bloquant ainsi pratiquement tout signalement vers l’extérieur. Si la démarche semble légitime, le lanceur d’alerte ne faisant que rendre service à son employeur·euse·s en communiquant un problème interne, que faire s’il soupçonne la direction de tolérer ou même d’encourager ces irrégularités, risquant ainsi des représailles en les signalant? Tributaire de la culture régnant dans l’entreprise, ce système privilégie lourdement les intérêts d’un employeur·euse·s à garder la confidentialité sur ses activités, même irrégulières, face à ceux de l’intérêt public à la poursuite d’actes répréhensibles autrement invisibles.
La pression populaire – le signalement au public comprenant les médias et ONGs – ne serait justifiée légalement que dans deux situations : lorsque le whistleblower a déjà été pénalisé dans son travail, ou que l’autorité compétente ne l’a pas informé assez tôt de la suite donnée à son signalement. Cela pourrait également se révéler problématique dans des affaires politiques sensibles, au cas où la justice chercherait à éviter de devoir enquêter ou retarderait inutilement les contrôles nécessaires.
On s’étonnera finalement de l’opposition à un renforcement de la protection contre le licenciement probable du whistleblower. Au vu de l’intérêt public que représentent des lanceurs d’alerte ayant communiqué de bonne foi à leur employeur·euse·s, aux autorités, subsidiairement au public, ainsi que de l’impact à long terme de cette décision sur leur vie, il serait pertinent d’augmenter les indemnités actuelles envisageables et de s’inspirer de la loi sur le personnel de la Confédération comme de la loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes, qui permettent également à l’employé·e de ne pas perdre toute perspective professionnelle après un conflit lié aux rapports de travail.
Rendez-vous est donc donné le jeudi 2 mai à Berne, où les parlementaires suisses devront une fois de plus décider des intérêts à faire prévaloir entre les exigences de confidentialité des entreprises et les besoins de transparence liés au monde des affaires.
Image: Unsplash