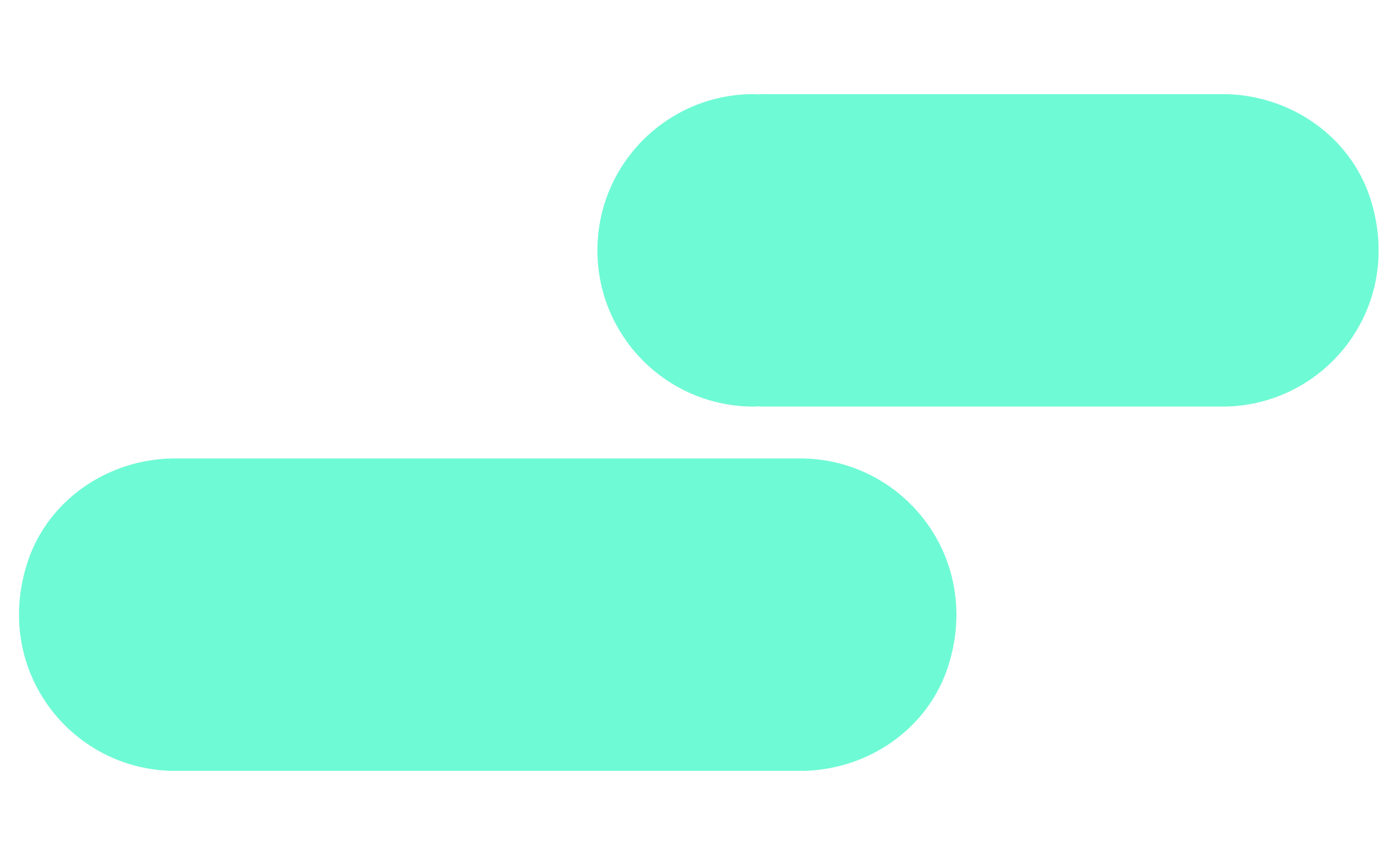Speranta Dumitru, maître de conférences en Sciences Politiques à l’Université Paris Descartes, nous explique dans une interview réalisée par Johan Rochel du foraus comment le sédentarisme nous fait manquer certaines opportunités.
Etant la norme dans un contexte de frontières fermées depuis la 1ère Guerre mondiale, le sédentarisme nous fait perdre des opportunités tant au sens large (culturelles, informationnelles, interpersonnelles) qu’économiques. Dans le cadre de l’accès à l’Etat social par les migrants, Speranta propose notamment d’intégrer le facteur de la mobilité comme élément fondamental du système des contributions et de protection sociale.
Johan Rochel : Le nombre de migrants internationaux est étonnamment stable. Depuis les années soixante, il oscille autour de 3% de la population mondiale. Ce qui signifie que 97% des habitants de la planète résident dans le pays où ils sont nés. Au fond, la sédentarité n’est-elle pas la norme ?
Speranta Dumitru : La sédentarité semble être la norme, mais il importe de comprendre pourquoi. D’abord, ce chiffre de 3% est mesuré dans un contexte de frontières presque fermées. Combien de gens migreraient-ils si les barrières à la mobilité internationale étaient levées ? Un sondage international mené par Gallup en 2011 indique que près de trois fois plus de gens seraient prêts à devenir des migrants, soit environ 600 millions de personnes. Ce chiffre est important, mais il reste toujours assez modeste : 90% de la population mondiale habiterait toujours dans son pays d’origine. Pour certains, trois fois plus migrants est une perspective inquiétante – preuve que notre façon de penser la mobilité internationale a beaucoup changé. Ce changement est relativement récent. Avant la Première Guerre Mondiale, la migration était un phénomène beaucoup plus important qu’aujourd’hui et les gens partaient et revenaient beaucoup plus librement. Par exemple en ouvrant le New-York Times du 3 avril 1903, on apprend que 12’000 personnes pouvaient arriver en un seul jour au seul port d’Ellis Island, à New York (« Big Army of Immigrants: Nine ships bring 12,668 Foreigners from European Ports ») ! Aujourd’hui, pour moins que cela, on se considère « envahis ». Notre façon de concevoir la mobilité internationale a changé durant un siècle : la généralisation du régime des passeports après la Grande Guerre, puis des visas et des lois migratoires a rendu la mobilité non seulement difficile, mais difficile à concevoir. La fermeture des frontières et les politiques migratoires ont sédentarisé nos esprits. Au-delà des chiffres, c’est le phénomène de sédentarisation des imaginaires qui m’interpelle. Notre vision sédentariste du monde est en désaccord avec nos discours sur la mondialisation.
Rochel : Qu’entendez-vous par vision sédentariste ?
Dumitru : Nous nous voyons difficilement partir et nous regardons la migration comme une anomalie, un phénomène exceptionnel. Notre réalité, nos débats, nos imaginaires sont prisonniers d’une vision sédentariste, et de surcroit liée aux espaces nationaux. Tout se passe comme si le monde se réduisait au cadre de l’Etat national, à un conteneur fermé et rassurant qui seul peut donner sens à la réalité, aux politiques et à nos vies. Le socio-psychologue Michael Billig parle d’un « nationalisme banal », qui s’est imposé profondément dans nos esprits. Vous pouvez regarder comment les médias « plantent le drapeau national » chaque jour dans nos vies par le choix des sujets et par la façon de les aborder. Ce biais national nous empêche d’envisager d’autres réalités, au-delà de la frontière nationale, ce qui nous fait manquer des opportunités. Des opportunités au sens large – culturelles, informationnelles, interpersonnelles – mais aussi économiques – de travail, de production et d’échange. Une partie de cette perte est due à notre biais national – ce que les économistes appellent « l’effet de frontière » : le volume des échanges à l’intérieur des frontières est beaucoup plus important qu’à travers les frontières, même en condition d’ouverture de frontières. Mais une autre partie de cette perte est due aux politiques nationales et à la fermeture des frontières pour les marchandises et les personnes. Ces pertes sont colossales : les économistes estiment qu’une levée des restrictions de la mobilité humaine à l’échelle globale permettrait de doubler le PIB mondial. Michael Clemens, un économiste de Washington, qui passe en revue ces estimations intitule son article « des milliers de milliards de dollars laissés au bord de la route ». Même des économistes plus pessimistes, comme Frédéric Docquier, estiment qu’en tenant compte de nombreux coûts, l’augmentation serait de 10-12% du PIB mondial. Ces chiffres, impressionnants, devraient nous amener à questionner notre façon de voir les frontières comme des barrières nécessaires et utiles. Nous perdons beaucoup d’argent et des opportunités tant que nous continuerons à penser de cette manière.
Rochel : Mais si nous pensons parfois en priorité à l’Etat national, c’est avec de bonnes raisons. L’Etat garantit des libertés et nous protège en cas de coups durs, via ses prestations sociales.
Dumitru : Les questions de justice sociale sont souvent invoquées pour restreindre la mobilité. L’équation essentielle n’a pas changé depuis les premières Lois sur les pauvres dans l’Angleterre du 16ème siècle. A l’époque, on oblige les paroisses à s’occuper des paroissiens les plus démunis. Pour clarifier et limiter leurs responsabilités de charité, ces paroisses édictent des certificats de résidence : seuls les résidents sont aidés. Le revers de la médaille est que la mobilité des habitants est entravée. Une bonne idée – celle de la protection sociale contre la pauvreté – devient un blocage de la mobilité pour ses propres paroissiens et pour les autres. On met en place un système qui va empêcher les gens d’aller là où leur force de travail est demandée et qui leur permettrait de gagner leur vie. L’équation que nous devons résoudre aujourd’hui est restée la même.
Rochel : Devrait-on envisager de limiter drastiquement l’accès à l’Etat social pour les migrants qui souhaitent tenter leur chance dans un nouveau pays ? Pourquoi ne pas imaginer qu’à moins d’avoir une place de travail ou des revenus personnels, tout accès à l’Etat social soit bloqué ?
Dumitru : Notons tout d’abord que les migrants ne viennent pas pour profiter de nos prestations sociales. On ne traverse pas des mers et des continents en investissant plusieurs dizaines de milliers d’euros pour venir toucher 500 euros à l’assistance. Les migrants qui arrivent en Europe, y compris au titre de l’asile, ont des réelles capacités et veulent travailler au même niveau de salaire que le nôtre. Si nous les laissons tenter leur chance, ils sauront la saisir et créeront des emplois.
Rochel : Permettez-moi d’insister : doit-on se préparer à l’émergence d’une sorte de classe sociale « migrante » qui serait exclue des prestations de l’Etat social ? Sommes-nous prêts à accepter ce genre d’évolutions, s’il s’agit du prix à payer pour accorder plus de mobilité ?
Dumitru : Si vous fuyez une zone de conflits, préférez-vous être en Europe sans prestation sociale, ou sur place en danger de mort ? Mais à mon avis, la question ne se pose pas en des termes si binaires. Au lieu d’envisager l’exclusion des migrants des prestations sociales, nous devons repenser les systèmes de contribution et de protection sociale en intégrant la mobilité comme élément fondamental. L’Union Européenne a déjà commencé à adapter le système de protection sociale à la mobilité intra-européenne. Si la liberté de circulation des travailleurs est l’une des quatre libertés fondamentales, comment faire pour que les travailleurs qui ont changé de pays ne perdent pas les cotisations qu’ils ont versées dans un autre système national de chômage ou de retraite ? Dans certains pays européens, ces cotisations sont prélevées automatiquement de sorte qu’une personne ayant travaillé toute sa vie dans plusieurs pays contribue à la protection sociale des autres tout en se retrouvant elle-même sans protection sociale à l’âge de la retraite. Un tel système n’est pas équitable et nous devons développer une vision plus déterritorialisée de la protection sociale. La mobilité des droits sociaux, corollaire de celle des hommes et des femmes, sera un défi politique et administratif très important pour le 21ème siècle. L’Europe s’y attèle peu à peu en coordonnant les systèmes de protection nationaux, mais nous devons penser cela au niveau global. Personne n’évalue le montant des contributions qu’on a prélevées aux migrants qui sont aujourd’hui partis ou qui ont été expulsés avant de bénéficier de chômage ou de retraite.
Rochel : Autre question liée au biais sédentariste que vous décrivez : le projet européen n’est-il justement pas en train de profondément remettre en question les cadres nationaux ? La libre circulation des citoyens européens n’est-elle pas la preuve la plus tangible que nous savons penser en dehors des Etats?
Dumitru : C’est vrai, même s’il faut noter que la mobilité intra-européenne reste encore assez faible – du moins telle que nous la mesurons actuellement, comme un changement de résidence pour une durée d’au moins un an. Le principe de la libre circulation de travailleurs, gravé dans les traités européens, illustre bien l’intérêt que nous avons à lever les barrières à la mobilité. Lors de la crise économique en Espagne, alors que les perspectives étaient au plus bas, la libre circulation a permis aux Espagnols de chercher un emploi en Allemagne. La liberté de circulation fait partie de la protection sociale, elle est une assurance contre les risques économiques. Les citoyens et les travailleurs y gagnent clairement. Mais la liberté de circulation ne doit pas être pensée que pour les migrants qui travaillent. Par exemple, les retraités des pays de l’Europe du Nord viennent passer la moitié de l’année en Espagne. Dans ce cas, le droit à la mobilité est au bénéfice des migrants retraités (qui ne travaillent pas, mais achètent des biens et des services), aussi bien qu’à l’avantage des travailleurs espagnols (qui n’ont pas besoin de se déplacer pour trouver du travail). Penser la mobilité avec des oppositions simplistes citoyens/immigrés migration de travail/migration humanitaire nous fait perdre de vue que la mobilité est une composante essentielle de toute activité humaine, à tout âge et à des fins diverses. Les discours populistes diabolisent la « migration » sans penser que la mobilité fait partie de nos vies et nous ouvre des opportunités que personne ne souhaiterait sincèrement voir disparaître.
Rochel : On affirme souvent que le projet européen peut être menacé par un afflux de migrants des pays tiers. Pour garder ces opportunités et cette prospérité, devrait-on continuer à lever les barrières intra-européennes, tout en renforçant les frontières de l’Europe ?
Dimitru : Nous dépensons déjà des milliards d’euros pour surveiller nos frontières avec l’agence Frontex, mais cette perte ne se réduit pas à ces milliards : nous détruisons aussi des opportunités économiques et sociales. Imaginez qu’au lieu d’ouvrir les frontières dans l’Union Européenne, les politiques avaient choisi de faire des politiques migratoires dans l’espoir d’obtenir les mêmes bénéfices que nous avons obtenus aujourd’hui par l’ouverture des frontières. Quel planificateur aurait pu prévoir que le désir de soleil des retraités des pays nordiques puisse créer des opportunités de travail pour les Espagnols en temps de crise ? Et si ce planificateur avait pu l’imaginer, combien de visas aurait-il dû donner aux retraités nordiques pour créer mille emplois pour les Espagnols ? Et est-ce que les retraités seraient venus juste parce qu’il y avait un nombre de visas et précisément dans l’année où il y avait la crise en Espagne ? Ce que je veux dire, c’est que les opportunités économiques se créent par la rencontre des gens, favorisées par la liberté de circulation, et non parce qu’un planificateur l’a décidé. Les bénéfices qu’on a obtenus par l’ouverture des frontières ne pouvaient pas être crées par une politique d’immigration intra-européenne, similaire à celle que l’Union Européenne veut mettre en place avec les pays tiers. Renforcer les frontières externes nous fait perdre de l’argent et des opportunités pour nous, pour les migrants, et pour les pays d’origine. Aujourd’hui, le piège qui nous menace, c’est celui de céder, chacun dans nos pays, aux populismes d’Europe. Notre perspective strictement européenne nous empêche de voir que d’autres zones du monde tentent de construire des zones de libre circulation, comme au MERCOSUR ou les pays d’Afrique de l’ouest.
Rochel : Cela ne semble pas être la direction prise. A l’inverse, les barrières à la mobilité vont croissantes.
Dimitru : En effet ! Et les politiques migratoires ne font que renforcer ce que j’appelle les « privilèges de naissance ». Le lieu de naissance est un fait dont il ne s’agit ni d’être fier, ni honteux. Mais la fermeture des frontières amplifie les inégalités associées à la loterie de la naissance. Le professeur new-yorkais Branko Milanovic a montré que la moitié des inégalités à l’échelle mondiale sont dues au lieu de naissance. Comment réduire l’impact de la loterie de naissance sur les inégalités ? Une façon de faire est de réduire au minimum les coûts de la mobilité. Ce sera alors la motivation, la force de travail et le talent des personnes qui seront décisifs, et non le lieu leur naissance et la couleur de leur passeport. Malheureusement, nous prenons le chemin inverse en choisissant de sur-privilégier ceux qui sont nés au bon endroit et en enfonçant un peu plus ceux qui sont nés pauvres. Regardez la couleur de votre passeport et demandez-vous si les frontières vous sont plutôt ouvertes ou fermées.
Rochel : Vous évoquiez l’intérêt pour les pays d’origine. Doit-on lier l’argument de liberté avec les offertes à ces pays ?
Dimitru : Si nous laissons les personnes libres de chercher des solutions à leurs défis, nous mettons les meilleures chances de notre côté. Car qui sait mieux où sont les opportunités que les migrants eux-mêmes ? L’impact positif de la migration sur le développement des pays d’origine est bien documenté. Si l’on prend en compte que les transferts d’argent des migrants vers leur famille et leur communauté, les sommes sont colossales : quatre fois plus que l’aide publique au développement. L’impact de la migration sur la réduction de la pauvreté (c’est-à-dire du nombre de personnes qui vivent avec $1,25 par jour) est aussi bien documenté. La migration est une opportunité pour les migrants, pour leur pays d’origine, mais aussi pour les pays riches, en augmentant légèrement le revenu des natifs. Laisser les gens agir de manière autonome contribue à faire émerger des solutions qu’aucun planificateur ne peut identifier assis dans son bureau.
Rochel : Soit, mais pourquoi ces éléments ne sont pas entendus ? Quel argument opposer aux populismes d’Europe, crispés sur les identités nationales ?
Dimitru : L’identité nationale telle qu’elle est pensée par les populistes est vraiment une mauvaise affaire, dans le sens strict du terme. Laissez-moi proposer une analogie avec une entreprise. Une entreprise est florissante si son carnet de commandes est rempli. Si les gens veulent acheter ses produits, elle peut investir, engager plus de personnel, améliorer ses prestations et, de manière générale, en tirer une certaine fierté. Avec les politiques d’immigration, nous sommes pourtant prêts à accepter exactement l’inverse : l’objectif politique fondamental semble être de rendre un pays le moins attractif possible. Mais détrompons-nous : le fait que les Syriens ne veuillent pas venir en France, mais préfèrent aller en Allemagne, n’est pas une bonne nouvelle pour la France. Cela devrait nous inquiéter profondément et ce, pour des raisons égoïstes. Une entreprise dans la même situation souffrirait d’un risque de spirale négative. Elle perdrait en attractivité, se refermerait et finalement s’enfoncerait dans les chiffres rouges. On devrait alors forcer les employés de l’entreprise à acheter leurs propres produits pour éviter la faillite. On voit déjà cette logique avec le slogan « acheter français » et nous devrions en être inquiets plutôt que de la saluer comme un signe de patriotisme. Le véritable patriotisme est de faire en sorte que l’entreprise France soit attractive pour tous, ce qui lui donnerait du dynamisme et de la croissance.
Cette analogie est utile pour penser l’identité nationale de manière moins coercitive. Une entreprise n’impose pas ses produits et sa ligne à ses clients : elle les rend attractifs, elle essaye de comprendre la psychologie et les valeurs de ses nouveaux clients et s’y adapte pour mieux vendre ses propres produits. Nous devrions penser l’identité nationale avec un esprit marketing : au lieu de forcer les migrants à signer un contrat d’accueil pour respecter « nos » valeurs nationales, nous devrions montrer en quoi ces valeurs sont importantes et attractives pour tous. A l’inverse, si la France n’attire plus grand monde, même ceux qui fuient la guerre, nous devrions être inquiets et prendre des mesures contre un tel manque d’attractivité. Et cela est vrai pour tous les autres pays européens qui n’attirent pas ou plus de migrants.